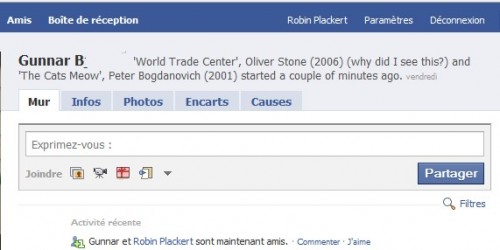25 septembre 2009
Le problème d'Aladin
Nous avions laissé Vila-Matas en pleine déploration sur Barcelone. Dans une autre passage de son Journal volubile il récidive : pendant le pont de la Toussaint 2007, il écrit qu'on "peut presque percevoir le profond silence des habitants de la ville qui sont partis en masse, oubliant - c'est dans l'air du temps - aussi bien la révolution que les morts."
"La débandade générale, poursuit-il, montre clairement que, à l'instar de la révolution, le vieux culte des morts file déjà un mauvais coton en Occident et que Barcelone ne fait pas exception à la règle. On ne coexiste plus, comme jadis, avec les ancêtres et on s'éloigne dangereusement de la culture de la mémoire. Jadis on coexistait avec les morts qui mouraient mais faisaient toujours partie du paysage moral."
Que lit-il au même moment ? Rien moins que Campo Santo de W.G. Sebald. "Dans tous les livres de cet auteur, précise-t-il, on trouve une prose méticuleuse et posée qui, dans sa morosité illimitée, se bat pour récupérer la souffrance, le deuil et la mémoire."
Il enchaîne en racontant qu'hier un livre s'est détaché d'un rayonnage, roulant par terre, livre qui se révéla être Le Problème d'Aladin d'Ernst Jünger. "Feuilletant les premières pages, je me suis rendu compte que Jünger avait été, lui aussi, obsédé par certains aspects de la décadence du culte des morts qui donnent tant de fil à retordre à son compatriote Sebald. Il est fort probable que, dans la vie, ils ne s'intéressaient guère l'un à l'autre, mais relisant Le Problème d'Aladin, je n'ai pu m'empêcher qe trouver que ces deux écrivains, à première vue si incompatibles et, au fond, très proches quant à leur inquiétude sur la perte accélérée de la mémoire dans notre culture, avaient en commun quelque chose d'insoupçonné."
J'ai lu un certain nombre de livres de Jünger, mais pas Le Problème d'Aladin, cependant je me souviens qu'il l'évoque dans les Entretiens avec Julien Hervier. De fait, j'y retrouve au chapitre XI les mots même qu'emploie Vila-Matas pour résumer la pensée de Jünger, et c'est à se demander si ce n'est pas précisément à ce volume d'Entretiens (publié chez Gallimard, dans la collection Arcades en 1986) qu'il a puisé l'essentiel de son propos :
"Comment la culture est-elle née ? Elle est née avec le culte des morts, avec la vénération religieuse des ancêtres ; cela a commencé avec les pyramides et avec les tumulus que construisaient les hommes préhistoriques, avec leurs cavernes et leurs grottes. Tout cela se perd, et même n'existe plus. Si je me suis penché sur ces questions de sépultures, c'est que je tiens le fait que le culte des ancêtres ait beaucoup souffert pour un trait caractéristique de la décadence actuelle. Quand je vais me promener dans un cimetière, je suis saisi par un sentiment de tristesse qui n'est pas dû aux malheureux défunts, mais à l'épouvantable uniformité avec laquelle on pense à eux."
Dans Campo Santo, on l'a vu, se trouvent des illustrations frappantes de cette place qu'occupaient les morts dans la société corse.
Maintenant, je voudrais juste terminer sur un autre extrait éclairant d'une interview de Sebald, reprise dans le volume intitulé L'archéologue de la mémoire, Conversations avec W.G. Sebald, paru cette année chez chez Actes Sud. Carole Angier pose une question concernant son livre Les Emigrants :
C. A. : Pouvez-vous nous parler de cet ami du Dr Selwyn, Johannes Naegeli, qui était guide de montagne, et de cette incroyable coïncidence qui fait qu'un jour, dans un train, vous êtes tombé par hasard sur un article qui relatait la découverte de son corps, rejeté par le glacier soixante-douze ans après sa disparition ? Cela illustre tellement bien votre ouvrage - "Voilà donc comment ils reviennent, les morts".
W.G.S. : Le Dr Selwyn m'avait parlé de l'époque où il avait vécu en Suisse avant la Première Guerre mondiale, de ce guide de montagne suisse avec qui il s'était lié d'amitié, et à quel point cela avait été important pour lui. Plus tard je n'avais pas réussi à me souvenir du nom qu'il avait mentionné ni même s'il avait mentionné un nom. Ni s'il avait précisé que son ami avait disparu. Mais j'ai bel et bien trouvé cet article dans un train, juste au moment où je commençais à écrire cette histoire. Un guide de montagne, la même année, au même endroit... Il suffisait d'un petit ajustement pour que ça concorde."
00:26 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vila-matas, sebald, jünger, barcelone, aladin, julien hervier
16 septembre 2009
Histoires minuscules et parallèles
Enrique Vila-Matas (Journal volubile) : "La vie fabrique d'étranges coïncidences. Au petit matin alors que je m'inquiétais de l'éventuelle destruction du fabuleux palmier de la rue Cardener que j'ai devant chez moi, Isabel Nuňez se souciait de celle, si redoutée, du merveilleux jujubier de la rue Arimon où elle habite. Histoires minuscules et parallèles, petits malaises graves."
Un peu plus loin : "D'autres coïncidences : avant d'habiter cette maison qui est en face du palmier de la rue Cardener, je suis longtemps resté dans un appartement de la rue Arimon, (...). J'ai trouvé des informations concernant le jujubier sur le blog d'une amie d'Isabel Nuňez (www.objet-a.blogspot.com) : "Cet arbre (Zizyphus Jujuba), ginjoler en catalan, originaire de Chine, arriva probablement en Andalousie par le biais de la culture arabe. Pékin en est plein, il est très répandu dans les cours des Hutons et dans les maisons traditionnelles. En Espagne, il y en avait beaucoup à Grenade. A Barcelone, il y en a un, rue Arimon."

Barcelone, avril 2006 (voyage personnel)
Chez Vila-Matas, réalité et fiction sont si entremêlées que l'on se prend à douter de tout. Ainsi, j'ai vérifié si le blog mentionné était bien réel. Il l'est. On peut lire aussi le blog d'Isabel Nuňez. Sur le site officiel de Vila-Matas, on peut d'ailleurs consulter une liste assez longue de blogs qu'il aime à fréquenter : aucune marque de mépris ou de condescendance vis-à-vis de ce support d'expression, comme en rencontre encore souvent chez les écrivains français. De même, je suis certain que les coïncidences, ils ne les inventent pas. Pourquoi d'ailleurs les inventer lorsque la vie vous en propose si régulièrement qui défient l'imagination ?
Il y a un point commun entre ces écrivains de la coïncidence, que ce soit Sebald, Auster ou Vila-Matas, c'est l'absence de théorisation du phénomène. Rappelons ce qu'a dit Paul Auster de son Carnet rouge : un art poétique sans théorie. Oui, aucune tentative d'explication n'est à relever, aucune invocation d'un principe subtil ou d'une instance cachée, aucune perspective transcendantale ou parapsychologique. Les faits seuls, rapportés précisément. Le mystère pur des faits.
L'inexplicable de l'improbable.
Il reste cette petite commotion intime que nous procure la coïncidence quand nous la vivons On peut s'en débarrasser aisément en jugeant que ce n'est justement qu'une coïncidence, et disant cela nous présupposons que ce n'est en somme qu'une rencontre fortuite, ce n'est que le fameux croisement de deux chaînes causales indépendantes. Un épiphénomène sans conséquence, un détail mineur sur la toile de fond de la vie, au bout du compte une broutille. Au fond de soi-même, cependant, pour quelques-uns d'entre nous, c'est du sens qui cherche à poindre, c'est parfois un signe qui éclaire l'horizon, c'est un accord soudain dans le tohu-bohu des existences, accord qui peut être aussi l'écho d'une dissonance.
Car où nous emmène donc Vila-Matas avec ses arbres en péril ? Rien moins que sur une réflexion très générale et relativement désabusée sur le devenir de sa ville :
" Je sais bien que la fin du jujubier, du cèdre et du palmier ne signifie pas la fin du monde, mais c'est à partir de petits malaises graves que se forge un grand malaise grave et se répand cette rumeur que beaucoup d'entre nous avons déjà entendue et qui dit que la ville étant vendue à la spéculation immobilière et à un tourisme qui nivelle tout, l'industrie culturelle étant offerte à Madrid, on assiste à la fin de Barcelone. Et il n'y a pas que la barbarie qui, en une seule matinée, est arrivée jusqu'à moi par trois voies différentes (preuve de la somme élevée de sauvageries), mais aussi ce malaise croissant : constater que la ville n'est plus à nous, qu'elle est un grand parc thématique pour étrangers et qu'à force de stupidité, Barcelone court à sa perte, comme le confirmeront simplement les prochaines années."
17:42 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enrique vila-matas, barcelone, sebald, auster
13 septembre 2009
Journal volubile et Man on wire
Le voyage à faire le voici
Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel
Philippe Petit (Traité du funambulisme, Actes Sud, 1997)
Enrique Vila-Matas, autre écrivain majeur de la coïncidence, écrivais-je en note d'un article récent.
 De la médiathèque, je rapportai mercredi le dernier ouvrage du catalan : Journal volubile, publié chez Christian Bourgois, et m'y plongeai immédiatement, car la lecture de Vila-Matas est toujours jubilatoire. Le thème de la coïncidence ne tarda pas à affleurer, mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine note, transportons-nous plutôt vers la page 223 - nous sommes en décembre 2007 - et l'écrivain évoque le funambule Philippe Petit :
De la médiathèque, je rapportai mercredi le dernier ouvrage du catalan : Journal volubile, publié chez Christian Bourgois, et m'y plongeai immédiatement, car la lecture de Vila-Matas est toujours jubilatoire. Le thème de la coïncidence ne tarda pas à affleurer, mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine note, transportons-nous plutôt vers la page 223 - nous sommes en décembre 2007 - et l'écrivain évoque le funambule Philippe Petit :
"Paul Auster se souvient encore très bien et avec émotion du matin de 1974 où son ami le funambule Philippe Petit "fit un cadeau d'une étonnante et incontestable beauté à New York". Ce jour-là, Philippe Petit, après des mois de préparatifs, tendit à la surprise de tous un fil d'acier entre les tours jumelles du World Trade Center, alla d'une terrasse à l'autre et traversa le vide en quarante-cinq minutes immortelles." Paul Auster, ami de Vila-Matas, est un autre écrivain majeur de la coïncidence, comme en témoigne éloquemment Le Carnet rouge, un recueil de treize histoires vraies - Auster insiste bien là-dessus - qui reposent toutes sur des coïncidences improbables. "De son Carnet rouge, écrivent les éditeurs, où il consigne et même collectionne des événements étranges par leurs coïncidences, Paul Auster dit que "c'est un art poétique sans théorie". " J'ai ressorti le livre de son rayonnage et vu que je l'avais acheté à Lyon, dans la collection Babel, le 25 avril 1995. En août 1997, à La Châtre, c'est le Traité du funambulisme de Philippe Petit que je m'étais procuré, et c'est Paul Auster, encore lui, qui en signait la préface.
J'en étais donc là jeudi soir 10 septembre et jusqu'ici, je vous l'accorde, rien de remarquable à signaler. Le lendemain, je me rends à mon travail, à pied, mais j'arrive un peu en avance, la grille du bâtiment où doit avoir lieu la réunion est encore fermée. Je repars en sens inverse et, au petit marchand de journaux de la Place Monestier, j'achète Le Monde. Pour passer le temps, je suis comme ça, j'achète des quotidiens nationaux menacés par la presse gratuite et l'internet.
Mais c'est seulement dans l'après-midi que j'ai le temps de m'y plonger. Vendredi, jour du supplément littéraire. Or, dans un article de Florence Noiville sur le dernier roman de Colum Mac Cann, voici que resurgit le funambule :
"Au milieu de son nouveau roman, Colum McCann a glissé une photo. C'est une image rectangulaire, en noir et blanc, page 297. On y voit les tours du World Trade Center reliées entre elles par un câble, avec... qu'est-ce donc que ce point noir minuscule posé sur le fil ? Un homme ? Oui, un homme avec une perche dans les mains. Un homme dont la silhouette dessine comme une croix. Debout dans les nuages, il danse au-dessus du vide, à la hauteur du 110e étage...
Tout le livre tourne autour de cette "miniature noire dans un ciel orageux". Une vision qui reflète un fait divers réel : le 7 août 1974, un funambule nommé Philippe Petit - un Français - s'amusa à traverser, à 412 mètres du sol, la distance qui séparait alors les Twin Towers. "Ceux qui le virent se turent, écrit McCann. (...) Un silence terrible, superbe, à l'écoute de lui-même. Certains pensèrent à une illusion d'optique, un effet d'atmosphère. (...) D'autres se signèrent. Les yeux fermés, en l'attente d'un bruit sourd."
Le soir même, je retournai au Journal volubile et relisai les pages consacrés à Philippe Petit, et je m'avisai que nous étions précisément à cette date anniversaire du 11 septembre, qui n'a pas fini de hanter l'Amérique.
________________________________________
Hier soir, je reçois un message de Facebook : Gunnar B. m'a ajouté en tant qu'ami et je suis amené à confirmer ou non cette demande. Il faut savoir que je ne suis pas vraiment un usager de Facebook, j'y ai ouvert un compte par curiosité je ne sais même plus à quelle date, et depuis je n'y avais plus touché. Or, le 2 septembre dernier, Aurore B. B. m'ajoutait en tant qu'ami. C'était la première amie que j'avais sur Facebook... Elle avait découvert le blog et retrouvé ma trace sur le réseau (alors que je n'avais jamais donné une quelconque publicité à cette inscription). J'acceptai son offre par curiosité, et voici donc que son mari, Gunnar, suédois né la même année que moi, me sollicitait à son tour. J'ai également accepté (j'ai donc maintenant deux amis, c'est magnifique) d'autant plus que le message en tête de sa page résonnait furieusement avec la coïncidence que j'ai évoquée plus haut. Qu'on en juge :
22:20 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : philippe petit, enrique vila-matas, paul auster, world trade center, colum mac cann
15 août 2009
La grande fractale marine
 Le deuxième livre commencé après celui de Sebald est Zone, le dernier roman de Mathias Enard (Actes Sud, 2008), fresque puissante en vingt-quatre chants, sorte de moderne Iliade, traversé par toute la violence du XXème siècle. Histoire d'un homme qui, dans le train de nuit l'emmenant de Milan à Rome, se remémore parmi les soubresauts d'une considérable gueule de bois les épisodes souvent douloureux d'une existence rongée par la guerre et les remords. J'ai été frappé d'y retrouver une interrogation proche de celle de Sebald, question vibrante posée à soi-même et qui ne peut recevoir de réponse :
Le deuxième livre commencé après celui de Sebald est Zone, le dernier roman de Mathias Enard (Actes Sud, 2008), fresque puissante en vingt-quatre chants, sorte de moderne Iliade, traversé par toute la violence du XXème siècle. Histoire d'un homme qui, dans le train de nuit l'emmenant de Milan à Rome, se remémore parmi les soubresauts d'une considérable gueule de bois les épisodes souvent douloureux d'une existence rongée par la guerre et les remords. J'ai été frappé d'y retrouver une interrogation proche de celle de Sebald, question vibrante posée à soi-même et qui ne peut recevoir de réponse :
"(...) pourquoi cet intérêt pour le vieil Hollandais, pour les "étrangers" raflés en Egypte en 1956 et 1967, pour la prison de Qanâter, peut-être était-ce l'effet de Jérusalem, une volonté de pénitence ou de chemin de croix, sait-on toujours ce que les dieux nous réservent ce que nous nous réservons à nous-mêmes, le projet que nous formulons, de Jérusalem à Rome, d'une ville éternelle à l'autre, l'apôtre qui renia par trois fois son ami dans l'aube blafarde d'une nuit d'orage m'a peut-être guidé la main, qui sait, il y a tant de coïncidences, de chemins qui se recroisent dans la grande fractale marine où je patauge sans le savoir depuis des lustres, depuis mes ancêtres mes aïeux mes parents moi mes morts et ma culpabilité (...)" (pp. 76-77)
Particularité stylistique de ce roman : il ne comporte pas de point, quelques virgules et tirets, mais pas de point. C'est une immense et vertigineuse coulée verbale, une lave dévalant le flanc d'un volcan en éruption, charriant les gaz, les fumées et les débris d'un monde convulsif. Ne surtout pas en déduire que la lecture en est entravée et difficultueuse, bien sûr on est loin du petit roman calibré, égo ou gallocentré, empli de personnages falots et sympas, qui pousse comme chiendent sur les étals des libraires, mais on n'y trouvera pas non plus d'hermétisme et de didactisme pesant. Il suffit en fait de s'abandonner à son mouvement tectonique, à sa houle profonde, pour être porté à son tour vers une ample méditation où s'entremêlent l'horreur et la beauté.
11:01 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathais énard, zone, sebald
13 août 2009
Memoria et littérature
"Après notre déménagement de notre village natal de W. dans la petite ville de S., distante de dix-neuf kilomètres, en décembre 1952, dans le camion du transporteur Alpenvogel, mon horizon musical commença à s'élargir peu à peu. J'entendis Bereyter, l'instituteur, qui lors des sorties de classe que nous faisions avec lui emportait toujours sa clarinette dans une vieille chaussette, exactement comme le philosophe Wittgenstein, jouer diverses pièces et mélodies ravissantes, dont je ne savais pas qu'elles étaient de Mozart ou de Brahms ou tirées d'un opéra de Vincenzo Bellini. Bien des années plus tard, lorsque par un de ces hasards qui n'en sont pas, j'allumai la radio de ma voiture en rentrant chez moi dans la nuit, au moment précis où retentit le thème, si souvent joué par Bereyter, du deuxième mouvement du quintette avec clarinette de Brahms et où je le reconnus après tout ce temps passé, je fus effleuré à l'instant de cette reconnaissance, par ce sentiment si rare dans notre vie émotionnelle d'une presque totale apesanteur."
W.G. Sebald (Moments musicaux, in Campo Santo, pp. 217-218)
Voilà, dans l'un des derniers courts essais de Campo Santo, un exemple caractéristique de coïncidence sébaldienne. Il faut noter la précision du souvenir, jusque dans le déménagement compris comme rupture et dont la date, la distance et même le moyen de transport utilisé sont minutieusement renseignés. Détails qu'on pourrait juger facilement inutiles, mais que Sebald ne néglige jamais, ainsi la mention de la vieille chaussette qui nous conduit directement à Wittgenstein, libère en nous des images et entretient une sorte de suspense. Le hasard qui n'en est pas un n'est pas simplement enregistré comme une curiosité, un soubresaut de l'intellect, bien au contraire il provoque un affect puissant et la phrase se termine par ce mot d'apesanteur qui nous laisse à notre tour interloqué. Ce qui se joue là, en cet instant, remue les tréfonds de l'être.
Dans l'essai suivant, Sebald évoque la visite qu'il fit en mai 1976, à Stuttgart, au peintre Jan Peter Tripp. D'une gravure qui lui offrit celui-ci - représentant le magistrat Daniel Paul Schreber avec une araignée dans le crâne - il voit l'origine de nombreux textes qu'il écrivit par la suite, "y compris le procédé, le respect scrupuleux de la perspective historique, le patient travail de ciselure et la mise en relation, dans le style de la nature morte, de choses qui semblent fort éloignées entre elles." "Depuis, continue-t-il, je n'arrête pas de me demander quels sont ces liens invisibles qui déterminent notre vie, par où passent ces fils, ce qui relie par exemple ma visite dans la Reinburgstrasse au fait que là-bas, dans les premières années d'après-guerre, il exista un camp pour ceux qu'on appelait les displaced persons, dans lequel environ cent quatre-vingt policiers de Stuttgart firent le 29 mars 1946 une rafle au cours de laquelle, bien qu'ils n'aient découvert d'autres qu'un petit trafic d'oeufs, des coups de feu furent tirés, tuant un réfugié qui venait tout juste de retrouver sa femme et ses deux enfants."
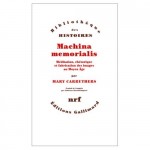 Sebald terminé, je me plongeai dans la lecture de deux autres livres a priori sans aucun rapport avec celui-ci. L'un des deux (je parlerai de l'autre dans un prochain billet) était l'essai de Mary Carruthers, Machina memorialis, sous-titré Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age, publié en 2002 dans la Bibliothèque des Histoires, chez Gallimard, acheté l'été dernier à l'abbaye de Saint-Savin. Je regrette presque de ne l'avoir pas abordé plus tôt, car il est absolument passionnant, et je n'arrête pas d'user mon crayon de papier dans le soulignage de maints et maints passages. L'art de la mémoire dans la méditation monastique, que l'universitaire américaine décrit à la suite des travaux pionniers de Frances Yates, loin de n'être qu'un exercice d'érudition déjà intéressant en soi, nous questionne aussi dans notre appréhension du monde contemporain. La géographie sacrée qui m'occupe trouve dans cette étude un écho inattendu, mais je reviendrai aussi là-dessus quelque jour. Qu'il me suffise aujourd'hui de souligner que j'ai pensé souvent à Sebald en découvrant le fonctionnement de la machina memorialis médiévale : la memoria ne devant pas être, comme souvent dans notre conception moderne, envisagée de façon réductrice comme un pur instrument de stockage d'informations, elle apparaît au-delà de cette fonction d'inventaire comme une fabrique de pensée propice à l'invention.
Sebald terminé, je me plongeai dans la lecture de deux autres livres a priori sans aucun rapport avec celui-ci. L'un des deux (je parlerai de l'autre dans un prochain billet) était l'essai de Mary Carruthers, Machina memorialis, sous-titré Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age, publié en 2002 dans la Bibliothèque des Histoires, chez Gallimard, acheté l'été dernier à l'abbaye de Saint-Savin. Je regrette presque de ne l'avoir pas abordé plus tôt, car il est absolument passionnant, et je n'arrête pas d'user mon crayon de papier dans le soulignage de maints et maints passages. L'art de la mémoire dans la méditation monastique, que l'universitaire américaine décrit à la suite des travaux pionniers de Frances Yates, loin de n'être qu'un exercice d'érudition déjà intéressant en soi, nous questionne aussi dans notre appréhension du monde contemporain. La géographie sacrée qui m'occupe trouve dans cette étude un écho inattendu, mais je reviendrai aussi là-dessus quelque jour. Qu'il me suffise aujourd'hui de souligner que j'ai pensé souvent à Sebald en découvrant le fonctionnement de la machina memorialis médiévale : la memoria ne devant pas être, comme souvent dans notre conception moderne, envisagée de façon réductrice comme un pur instrument de stockage d'informations, elle apparaît au-delà de cette fonction d'inventaire comme une fabrique de pensée propice à l'invention.
Les lieux de mémoire, architectures, manuscrits, cartes du ciel, sont les supports d'une activité qu'on peut qualifier de proprement "créatrice" : "Les visiteurs, écrit Mary Carruthers, page 58, "puisent" dans le matériau offert par le monument diverses "choses" (divers contenus) qu'ils vont ensuite "rassembler" pour les insérer dans leur propre histoire." Elle évoque ainsi les "réseaux de mémoire" des chrétiens lettrés, qui leur permettent de dépasser le sens littéral donné au texte biblique pour aller vers les "significations mystiques", qui seules distinguent l'infidèle du fidèle, selon Pietro Chrysologus, évêque de Ravenne au Vème siècle, confident de l'impératrice Galla Placidia (voir page 64).
Friedrich Hölderlin
N'est-ce pas à une semblable opération que se livre Sebald lorsqu'il écrit que "La seule chose peut-être à ajouter est que nous nous souvenons et peu à peu apprenons à comprendre qu'il existe des rapports bizarres, sans aucune logique de cause à effet, par exemple entre la ville de Stuttgart, ancienne résidence princière et plus tard ville industrielle, et la ville française de Tulle, s'étendant sur sept collines (...), Tulle en Corrèze par où Hölderlin passa en allant à Bordeaux et où le 9 juin 1944, trois semaines exactement après que je vis, comme l'on dit, la lumière du jour à Wertach, dans la maison Seefelder, et presque jour pour jour cent un ans après la mort de Hölderlin, la totalité de la population masculine de la ville a été regroupée dans la cour d'une usine d'armement par la division SS Das Reich envoyée en mission de représailles. Parmi eux, quatre-vingt-dix-neuf hommes de tous âges, au cours de cette journée noire dont l'ombre plane encore aujourd'hui sur l'esprit des habitants de la ville, ont été pendus aux lampadaires et aux balcons du quartier de Souillac." ?
Cela le conduit à poser la grave question : A quoi bon, alors, la littérature ? Il cite alors un passage de l'Elégie de Hölderlin :
Soll es werden Auch mir, wie den tausenden, die in den Tagen ihres Frühlings doch Auch ahnend und liebend gelebt aber am trunkenen tag von den rächenden Parzen ergriffen, ohne Klag und Gesang heimlich hinuntergeführt, dort im allzunüchternen Reich, dort büSen im Dunleln, wo die langsame Zeit bei Frost und Dürre sie zahlen, nur in Seufzern der Mensch noch die Unsterblichen preist.1? Le regard synoptique qui dans ces vers survole la frontière de la mort est assombri et néanmoins illumine le souvenir de ceux qui ont subi la plus grande injustice. Il y a de nombreuses formes d’écriture ; mais c’est seulement dans la littérature que l’on a affaire, au-delà de l’enregistrement des faits et au-delà de la science, à une tentative de restitution.
W.G. Sebald, Campo Santo, Une tentative de restitution, éditions Actes Sud, 2009, p. 238
____________
1. « En adviendra-t-il de moi comme de ces milliers d’autres qui ont vécu/les jours de leur printemps dans l’aspiration et l’amour/mais au jour de l’ivresse saisis par les Parques vengeresses/ont été en secret , sans cri ni complainte, menés/là-bas dans le trop austère royaume/là-bas expient dans l’obscurité/où sous un éclat trompeur se déchaine une folle agitation/où l’homme ne loue plus qu’en soupirant sans cesse les immortels. » Friedrich Hölderlin, Élégie, ed. Beisner, Carl Hanser Verlag, Munich 1970, t.1, p.264. (Passage de Sebald cité par Sylvie Durbec dans Poezibao)
16:25 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sebald, carruthers, chrysologus, tripp, mémoire, hölderlin, stuttgart, tulle