01 octobre 2006
Paris ne finit jamais
Entracte dans le feuilleton Denis Gaulois. Ceux qui me lisent régulièrement savent que je tire deux fils distincts sur ce site, l'un est bien entendu l'enquête autour de la géographie sacrée du Bas-Berry et ses alentours, l'autre est cette interrogation sur les coïncidences qui vient sporadiquement s'intercaler dans le cours de mes investigations zodiacales. Ces deux fils ne cessent d'ailleurs de se croiser, formant un brin qu'il serait bien artificiel de démêler. C'est comme une de ces pièces de théâtre élizabéthaines avec ses deux intrigues : la principale et la secondaire qui se dénouent ensemble au final. Sauf que le final ici n'est pas de mise...
 Ce préambule pour dire qu'au même moment où je m'évertuais à pénétrer cette obscure légende déoloise en poursuivant ma lecture de Montjoie et saint Denis !, je me suis offert le luxe d'une digression dans l'univers romanesque de l'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas. Je dis bien luxe, car cette initiative n'avait rien de raisonnable : le temps me manque déjà pour venir à bout des lectures entamées et je me rajoute une nouvelle dose d'imprimé. Cela, on en conviendra aisément, frise l'inconséquence... Pour venir à bout des scrupules qui naturellement me tenaillent (« Finis donc déjà ce que tu as commencé, tu verras bien après »), je me donne d' « excellents » prétextes : Villa-Matas, dont je n'ai lu jusqu'à présent que des extraits et quelques articles de revue, est un écrivain qui fait lui aussi la part belle aux coïncidences (avec une savante ironie qui est, semble-t-il, sa marque de fabrique et qui fait se demander toujours si ce qu'il raconte est, comme l'on dit trivialement, du lard ou du cochon). Par ailleurs, le livre de lui que j'ai choisi se nomme Paris ne finit jamais, ce qui fait écho à l'étude d'Anne Lombard-Jourdan dont il est dit (quatrième de couverture) qu'elle « éclaire ainsi de façon décisive les causes profondes de la primauté de l'abbaye royale de Saint-Denis et de la singularité et de l'ascendant de Paris capitale. » Ce livre se tenait donc dans le droit fil de mes deux problématiques (allons-y pour le mot pédant) exposées au-dessus.
Ce préambule pour dire qu'au même moment où je m'évertuais à pénétrer cette obscure légende déoloise en poursuivant ma lecture de Montjoie et saint Denis !, je me suis offert le luxe d'une digression dans l'univers romanesque de l'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas. Je dis bien luxe, car cette initiative n'avait rien de raisonnable : le temps me manque déjà pour venir à bout des lectures entamées et je me rajoute une nouvelle dose d'imprimé. Cela, on en conviendra aisément, frise l'inconséquence... Pour venir à bout des scrupules qui naturellement me tenaillent (« Finis donc déjà ce que tu as commencé, tu verras bien après »), je me donne d' « excellents » prétextes : Villa-Matas, dont je n'ai lu jusqu'à présent que des extraits et quelques articles de revue, est un écrivain qui fait lui aussi la part belle aux coïncidences (avec une savante ironie qui est, semble-t-il, sa marque de fabrique et qui fait se demander toujours si ce qu'il raconte est, comme l'on dit trivialement, du lard ou du cochon). Par ailleurs, le livre de lui que j'ai choisi se nomme Paris ne finit jamais, ce qui fait écho à l'étude d'Anne Lombard-Jourdan dont il est dit (quatrième de couverture) qu'elle « éclaire ainsi de façon décisive les causes profondes de la primauté de l'abbaye royale de Saint-Denis et de la singularité et de l'ascendant de Paris capitale. » Ce livre se tenait donc dans le droit fil de mes deux problématiques (allons-y pour le mot pédant) exposées au-dessus.
Quel est l'argument du livre ? Quatrième de couverture encore : « A l'occasion d'une conférence qu'il doit donner à Barcelone, un écrivain revient sur ses années de bohême et d'apprentissage littéraire à Paris. Sous la figure tutélaire d'Ernest Hemingway, il dit son amour pour cette ville à travers les souvenirs de ses premiers pas dans l'écriture. »
Bon, là-dessus, j'achète ce matin le Journal du Dimanche et voici qu'en dernière page du supplément Paris-Ile de France, je tombe sur un grand article de l'écrivain américain Jérôme Charyn, intitulé Le grand Paris de Hemingway. C'est une promenade jalonnée par les différents lieux parisiens marqués par le passage de « Papa », promenade où Charyn ne se prive pas d'égratigner le mythe à l'occasion.
Ainsi évoque-t-il la rencontre avec Scott Fitzgerald en 1925, au Dingo Bar, dans le 14ème : « A l'époque, l'auteur de Gatsby le Magnifique est idolâtré dans le monde entier. Mais il reconnaît tout de suite le talent de Hemingway. Et semble même impressionné par le jeune écrivain. Il l'aide d'ailleurs à faire publier Le soleil se lève aussi, le roman qui fait de lui une star.
C'est le début d'une amitié. Même si lors de cette première rencontre Scott pose des questions indiscrètes sur la sexualité de Hem' et finit la soirée ivre mort. Hemingway s'amuse à noter que, quand Scott est assis au bar, ses jambes sont si courtes qu'elles ne touchent pas le sol. Comme à son habitude, il ne peut s'empêcher de se moquer de la personne qu'il encense. »
Or, la page sur laquelle j'avais arrêté ma lecture du livre, la page 54, relatait précisément cette rencontre de 1925 entre Fitzgerald et Hemingway : « Ce fut le début d'une amitié qui commença sur un bon rythme et finit très mal. Paris est une fête raconte que, quelques jours après cette première rencontre , ils partirent tous les deux en train pour Lyon afin de récupérer la voiture décapotable que l'écrivain à succès y avait abandonnée, l'un l'écrivain très riche, brillant et déjà très célèbre (Scott Fitzgerald), et l'autre, un peu plus jeune et encore un débutant (Hemingway), un écrivain sans argent, avide de triompher et content d'avoir fait la connaissance de cette grande étoile de la littérature. »
Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à prendre note quasi systématiquement des coïncidences (en février 1991, dans un cahier Clairefontaine à couverture rose), la première page mentionnait déjà Hemingway, à travers une de ses nouvelles intitulée Une très courte histoire.
Cette histoire-ci promet en revanche d'être très longue...
23:00 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (2)
23 septembre 2006
Les Vergers du Ciel
Retour dans la blogosphère, et pas fier pour autant, car tout d'abord, du programme gaillardement annoncé dans la dernière note, il me faut bien avouer que je n'ai pas accompli l'ombre d'un début de commencement : Berque ? Dupront ? Toujours pas lus, toujours en souffrance dans le rayonnage des livres essentiels à lire impérativement... Le texte sur Glastonbury, le retour sur l'Homme Sauvage : procrastinés, oubliés, négligés. L'index, ah oui l'index, qui serait si commode, même pour moi : reporté à la Saint-Glinglin (son hagiographie reste à écrire, à celui-ci). Bon, le bilan n'est pas glorieux, mais c'est qu'en ces mois estivaux d'autres lectures se sont imposées, m'ouvrant d'autres horizons, parfois bien éloignées de la stricte géographie sacrée. Je me suis dispersé, éparpillé, et puis voilà, c'est l'automne et je vois bien qu'il faut que je me rassemble, que j'en termine avec cette circumambulation berrichonne. Une fin provisoire, je le sais déjà, j'ai mis seize ans à reprendre l'étude, 1989 – 2005, et peut-être qu'au bout de ce périple, j'en aurai ras le bol des symboles, des capricornes et des centaures, des taureaux et des verseaux. La différence, c'est que la chose ne dormira plus dans les tiroirs, elle se sera infusée dans l'imprévisible tissu de l'internet. Elle ne m'appartiendra plus complètement. Bien malin qui pourra dire ce qu'il en adviendra.
Avant d'en revenir à mon objet principal dans une note prochaine (la stratégie dilatoire a la peau dure...), j'ai le plus vif désir de vous conter la dernière coïncidence dont je fus le témoin, auditif en premier lieu.

Allant, le vendredi 8 septembre, en voiture d'Orsennes à Argenton, je tombe sur l'émission A voix nue, de France-Culture, où Sophie Naulleau reçoit pour le dernier jour Jean-Pierre Sicre, fondateur des éditions Phébus. J'avais déjà surpris une bribe d'entretien un des jours précédents et j'écoute avec plaisir cet amoureux des livres et du bon vin.
« Un regret, c'est de ne pas avoir publié un romancier que j'adorais immensément, qui était Christian Charrière qui avait publié ses meilleurs livres chez Fayard dans les années 70, et qui se trouve être à mes yeux le plus grand romancier des années 70, avec le Tournier de la bonne époque et un ou deux livres de Georges Walter (...) notamment ces sublimes Enfants d'Attila qu'adorait tant Vialatte, mais Christian Charrière s'était arrêté au début des années 80 d'écrire. J'avais réussi à le persuader (...) de revenir au roman après plus de vingt ans d'absence, et il est mort l'été dernier. Ça, c'est un grand regret. Restent les livres (...), notamment les sublimes Vergers du Ciel qui est pour moi un des grands livres de littérature de son époque. »
Je ne connais pas George Walter, mais je me souvenais encore de la Forêt d'Iscambe de Christian Charrière, lu dans les années 80, cette pérégrination dans une France recouverte par la jungle et où les héros prenaient les vestiges des stations-service pour des temples dédiés au dieu Antar et à la déesse Shell... Là-dessus, j'arrive - aux alentours de midi – à Argenton-sur-Creuse où j'ai coutume de hanter à cette heure-ci la Maison de la Presse. Presque en face, de l'autre côté de la rue, une petite librairie étroite et peu avenante a disposé sur le trottoir deux étals de bouquins d'occasion. N'ayant point trouvé pitance à la Maison de la Presse, je traverse à tout hasard. Surprise, parmi la petite cinquantaine de volumes qui s'offrent là, défraîchis, jaunis, à vrai dire peu ragoûtants, je remarque Les Vergers du Ciel, encore adorné du bandeau Christian Charrière... L'édition originale de 1975. Ce n'est pas tout, trois ouvrages plus loin, que vois-je ? Les Enfants d'Attila, de Georges Walter. Les deux livres que Sicre vient de citer il y a quelques minutes... Pour la bagatelle de six euros, je m'en rends possesseur.
 Cela sonne bien sûr comme un signe, un appel. C'est comme si des puissances tutélaires vous accordaient une grâce soudaine. Maintenant, quel sens donner à cette rencontre ? Je me dis que peut-être un de ces livres va m'apporter un enseignement essentiel. Rien n'est moins sûr. Pourtant, peu de temps après, j'abandonne mes autres lectures en cours pour Les Vergers du Ciel. Au départ, je suis séduit par l'écriture, le lyrisme de la phrase, les images riches et nombreuses, même si l'intrigue m'indiffère, voire m'ennuie. Mais je reconnais que ces vergers perchés au sommet de la ville, qui laissent choir leurs fruits de lumière sur les maisons en contrebas et la rivière ombreuse, exhalent une réelle poésie. Je vais donc dans ma lecture comme un orpailleur à la recherche de la pépite. Mais la quête s'avère vaine, ou je ne sais pas voir. Plus l'histoire avance et moins j'y adhère ; certaines figures de style me semblent trop récurrentes et surtout je me fatigue de cette thématique de l'ombre et de la lumière infiniment ressassée, au point de presque faire système. Et je crois comprendre pourquoi Charrière a abandonné le roman pour se consacrer à des essais de spiritualité, de symbologie et d'interprétation des rêves. Quelque chose de desséchant est en germe dans cette fiction, une sorte de vision jungienne trop univoque. Au bout du compte, je laisse tomber, je rends les armes à la moitié du livre. Non sans quelque remords, mais je n'en pouvais plus.
Cela sonne bien sûr comme un signe, un appel. C'est comme si des puissances tutélaires vous accordaient une grâce soudaine. Maintenant, quel sens donner à cette rencontre ? Je me dis que peut-être un de ces livres va m'apporter un enseignement essentiel. Rien n'est moins sûr. Pourtant, peu de temps après, j'abandonne mes autres lectures en cours pour Les Vergers du Ciel. Au départ, je suis séduit par l'écriture, le lyrisme de la phrase, les images riches et nombreuses, même si l'intrigue m'indiffère, voire m'ennuie. Mais je reconnais que ces vergers perchés au sommet de la ville, qui laissent choir leurs fruits de lumière sur les maisons en contrebas et la rivière ombreuse, exhalent une réelle poésie. Je vais donc dans ma lecture comme un orpailleur à la recherche de la pépite. Mais la quête s'avère vaine, ou je ne sais pas voir. Plus l'histoire avance et moins j'y adhère ; certaines figures de style me semblent trop récurrentes et surtout je me fatigue de cette thématique de l'ombre et de la lumière infiniment ressassée, au point de presque faire système. Et je crois comprendre pourquoi Charrière a abandonné le roman pour se consacrer à des essais de spiritualité, de symbologie et d'interprétation des rêves. Quelque chose de desséchant est en germe dans cette fiction, une sorte de vision jungienne trop univoque. Au bout du compte, je laisse tomber, je rends les armes à la moitié du livre. Non sans quelque remords, mais je n'en pouvais plus.
Tout ça pour ça ? Cette belle coïncidence pour ce lâchage final ? Cela pose question, en effet. Pourtant, examinons l'affaire de plus belle. Il y a matière à glose : c'est à Argenton, placé sur l'axe équinoxial, au départ du circuit zodiacal, que j'ai trouvé le livre. Equinoxe, équilibre de l'ombre et de la lumière qui trouve place fin septembre. Or, je l'apprendrai un peu plus tard sur un site web, c'est le 11 septembre 2005 que Christian Charrière a rendu l'âme. La maison Phébus, de Jean-Pierre Sicre, tire, elle, son nom du dieu solaire, apparenté à Apollon.
Mais nous sommes souvent devant les coïncidences comme des spectateurs stupéfiés ne sachant que penser de ce qui nous frappe, de ce qui nous étonne au sens presque étymologique du terme. Ce sont de petits récits qui nous laissent interdits, nous laissent juste entrevoir un ordre caché du monde, et je repense en écrivant ceci à ces lignes de J.B. Pontalis lus ce soir-même :
« Anton Ehrenzweig a parlé d’un « ordre caché de l’art ». L’ordre visible, je n’en veux pas. J’y vois l’ombre de la mort. Le chaos m’angoisse. Ce que je cherche dans l’art et d’abord dans la psychanalyse, c’est l’ordre caché dont personne ne peut se prévaloir d’être le maître. Un ordre qui, loin de lutter contre le désordre, ne fait qu’un avec lui. »
Mais je pense encore que je n'ai pas encore lu, ni même exploré sommairement Les Enfants d'Attila, l'autre livre. Et que peut-être...
00:05 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (3)
02 décembre 2005
De l'influence des camionnettes sur la géographie symbolique
Qu'on me permette une légère digression dans mon « périple » biturige. A priori, ça n'a rien à voir, mais... La semaine dernière, la maison voisine a été l'objet de menus travaux, réfection de chéneaux et gouttières à ce qu'il  semble, et un échafaudage a occupé le trottoir pendant quelques jours. Rien que de très ordinaire, sauf qu'un matin, sortant de chez moi, je m'avise que l'entreprise chargé de la besogne est basée à Saint-Léger, un minuscule hameau de la commune de Meunet-Planches. Or, j'ai déjà mentionné ce lieu-dit dans une note sur Saint-Denis-de-Jouhet. Et j'y reviendrai lors de l'étude du secteur Sagittaire, car ce Saint-Léger (dont j'ai déjà dit qu'il était l'unique toponyme représentant le saint dans le département) figure également sur un alignement Lys Saint-Georges-Issoudun. Le logo même de l'entreprise avec le clocher d'église me frappait comme un écho supplémentaire. Je trouvai amusant de retrouver Saint-Léger à ma porte, lui qui m'avait si fort occupé cet été. D'ailleurs, c'est sur le hameau en question que s'est achevé ma correspondance avec le webmestre du site de l'Association des Saint-Léger. J'avais, à son intention, rédigé un inventaire provisoire des Saint-Léger dans la géographie sacrée, mais j'ai sans doute échoué à éclairer sa lanterne, puisque je n'ai plus eu de nouvelles par la suite. Et le site léodégarien ignore toujours mes travaux (ce qui ne me soucie guère d'ailleurs, n'ayant jamais fait le siège d'aucun site pour qu'on y mentionne mes petites trouvailles, et n'étant pas pressé de changer ma politique à cet égard).
semble, et un échafaudage a occupé le trottoir pendant quelques jours. Rien que de très ordinaire, sauf qu'un matin, sortant de chez moi, je m'avise que l'entreprise chargé de la besogne est basée à Saint-Léger, un minuscule hameau de la commune de Meunet-Planches. Or, j'ai déjà mentionné ce lieu-dit dans une note sur Saint-Denis-de-Jouhet. Et j'y reviendrai lors de l'étude du secteur Sagittaire, car ce Saint-Léger (dont j'ai déjà dit qu'il était l'unique toponyme représentant le saint dans le département) figure également sur un alignement Lys Saint-Georges-Issoudun. Le logo même de l'entreprise avec le clocher d'église me frappait comme un écho supplémentaire. Je trouvai amusant de retrouver Saint-Léger à ma porte, lui qui m'avait si fort occupé cet été. D'ailleurs, c'est sur le hameau en question que s'est achevé ma correspondance avec le webmestre du site de l'Association des Saint-Léger. J'avais, à son intention, rédigé un inventaire provisoire des Saint-Léger dans la géographie sacrée, mais j'ai sans doute échoué à éclairer sa lanterne, puisque je n'ai plus eu de nouvelles par la suite. Et le site léodégarien ignore toujours mes travaux (ce qui ne me soucie guère d'ailleurs, n'ayant jamais fait le siège d'aucun site pour qu'on y mentionne mes petites trouvailles, et n'étant pas pressé de changer ma politique à cet égard).
J'en étais là de mes pensées sur l'affaire saint Léger, lorsque j'ai reçu le commentaire de Marc Lebeau (merci à lui) sur l'oppidum de type belge ou « de Fécamp » : une simple question technique à laquelle j'ai cherché réponse sur le Net, sans grand succès d'ailleurs, mais, en fait, j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas...
Je m'explique : tapant, entre autres, le mot-clé Fécamp, sur quoi tombai-je rapidement ? Ni plus ni moins que sur saint Léger lui-même. Car le pauvre évêque, après avoir eu les yeux crevés, la langue et les lèvres coupées, fut interné chez les moniales de Fécamp, avant d'être décapité en Artois.
Un peu plus tard, je découvre un site consacré à l'archéologie qui signale la mise en ligne du deuxième tome inachevé de « Mythes et Dieux de la Gaule » de Jean-Jacques Hatt, décédé en 1997. Or, dans la suite de mon étude sur la géographie sacrée biturige, comme on le verra bientôt, je parle de ce savant homme, auteur de l'article consacré aux mythes celtiques dans l'Encyclopadia Universalis. Ma position est plutôt critique d'ailleurs, mais elle devra peut-être être révisée à la lueur de la lecture de cet ouvrage : plus de 400 pages à lire quand même, je risque de prendre encore un peu plus de retard...
Enfin, car il n'y a pas que le net, je me suis plongé dans une petite étude qu'on m'a offerte récemment : Les Celtes de l'Age du fer dans la moitié nord de la France, par Olivier Buchsenschutz (La maison des roches, éditeur, octobre 2004). Je parcours le chapitre qui traite de la fortification, où il apparaît que les fermes de l'Age du fer étaient très souvent encloses :
« Cette clôture peut donc prendre des formes très variées suivant la période et le statut du propriétaire de la ferme. Légère, c'est un simple obstacle à la divagation du bétail ; mais quand le fossé dépasse 3 ou 4 mètres de profondeur, quand le talus se dresse à 5 ou 6 mètres, il s'agit d'une véritable défense, d'une construction monumentale qui manifeste la puissance des habitants. La régularité, la symétrie du plan, et le développement des entrées, comme dans la ferme d'Herblay, près de Pontoise, dénotent une recherche architecturale manifeste. Des sondages sur les sites de Meunet-Planches et de Luant (Indre) en 1999 ont même révélé la présence d'un véritable rempart en terre, pierre et bois, le murus gallicus décrit par César (VII, 23), alors que la surface enclose ne dépasse pas deux hectares. » (p. 83-84)
Meunet-Planches, où l'on a aussi retrouvé une des bornes milliaires qu'on plaçait sur les voies romaines, est ainsi considéré comme un site important dans la recherche archéologique contemporaine. Notons enfin que comme Saint-Léger, le bourg est situé sur les rives de la Théols, qui n'est autre qu'un affluent de l'Arnon (les deux rivières marquant en plusieurs endroits la limite entre les deux départements berrichons de l'Indre et du Cher).
Je vous le disais, a priori, ça n'avait rien à voir...
22:50 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (1)
01 novembre 2005
Raymond Hains
Richard Sünder
J'ai appris hier en lisant le journal de Jean-Claude Bourdais qu'un des grands facteurs de coïncidences de notre temps venait de mourir. Il s'agit de l'artiste Raymond Hains, qu'on rattache traditionnellement au mouvement des Nouveaux Réalistes, avec Arman, François Dufrêne, Yves Klein, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely et Jacques Mahé de la Villeglé, sous l'égide du critique d'art Pierre Restany. Incidemment j'ai retrouvé la trace de Richard Sünder, créateur de la théorie pansémiotique, dont il exposa jadis les passionnants et abscons linéaments dans l'éphémère journal Don Quichotte, et que depuis je n'avais jamais plus croisé. « La pansémiotique, est-il expliqué sur son site, est la théorie selon laquelle,tout, dans le cosmos, est signe, chargé, par le Surréel (ou les inconscients), d'une signification cachée, à destination de la conscience, qui a pour objet de la décoder. » Sünder raconte avec beaucoup d'humour une soirée passée avec Raymond Hains, intarissable causeur, écoulant sans grand souci de ses interlocuteurs, la cascade mouvementée de ses associations mentales.

Un facteur de coïncidences peut-il tirer sa révérence sans envoyer quelques signes discrets à la petite communauté des scrutateurs du hasard ? Je lis dans l'article du Monde, écrit par Philippe Dagen, que « D'un nom propre à un autre, d'un calembour à une homonymie, d'une allusion hermétique à une plaisanterie idiote, d'une référence extrêmement savante et rare à une blague, Hains tisse des filets de significations et de sous-entendus, laissant au spectateur le soin de ne pas s'y perdre. (...)La dérision est constante, le détachement aussi : à aucun moment, Raymond Hains n'a songé à tirer parti de sa notoriété et à poser au maître, encore moins à y trouver des avantages économiques, lui qui a mené une vie de "clochard céleste" et qui ne regardait qu'avec méfiance hommages et rétrospectives. Celle qui, après bien des retards, eut lieu au Centre Pompidou en 2001 s'intitulait justement"Raymond Hains, la tentative".
C'est en cela qu'il a été un Dada égaré dans une époque très peu faite pour une telle indépendance. Tout en se moquant des filiations et des historiens, il n'en accepta pas moins le prix Schwitters en 1997 de la ville de Hanovre. Cette distinction portant le nom de l'ironique artiste allemand était en effet la seule qui pouvait lui convenir. »
Il se trouve que c'est un collage de Shwitters qui trône en fond d'écran sur mon ordinateur depuis quelques jours, et que je viens juste d'achever la lecture du Cézanne de Philippe Dagen...
15:10 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (3)
08 août 2005
Valençay
« donnez moi ses mains duvetées creusées pour l'aumône » Jacques Roubaud (e )
Le samedi 30 juillet, nous nous rendîmes au château de Valençay. La visite du domaine de Talleyrand, (acheté par lui en 1803, à la demande de Napoléon et avec son aide financière) est agrémenté de saynètes mettant en scène le prince et divers protagonistes (serviteurs, nièce, cuisinier, aristocrate escrimeur...). Cette année, deux amis comédiens ont été engagés pour jouer durant l'été ces spectacles donnés dans la cour d'honneur ou les vastes cuisines (la table de Talleyrand était une des plus réputées d'Europe). Parfaitement rôdés après un mois de représentation, heureux de se produire en un tel lieu, ils ont bien restitué la figure ambiguë, séduisante, du roué diplomate à la verve étincelante.
Le soir-même, je termine ma note du Cheval Mallet sur l'évocation de Charles-Antoine de la Roche-Aymon. Si j'avais, en 1989, déjà reconnu la place occupée par cette famille dans la géographie sacrée du pays berrichon, je n'en avais pas pour autant identifié ce personnage, ni même repéré le blason porteur du fauve emblématique du signe. Une autre surprise m'attendait, plus circonstancielle : Charles-Antoine de la Roche-Aymon, je l'ai écrit, fut l'avant-dernier aumônier royal mais je m'aperçois aujourd'hui que j'ai fait une légère erreur, il en fut en réalité l'antépénultième. Avant-dernier, il le fut aussi, mais c'est de la charge d'Archevêque-Duc de Reims dont il se rendit titulaire en 1763, poste ô combien important symboliquement puisque c'est l'Archevêque-Duc de Reims qui avait le privilège de poser la couronne du Roi au cours de la cérémonie du Sacre. Maintenant, savez-vous qui fut, en 1777, le dernier archevêque-duc de Reims ? Eh bien, ni plus ni moins que Alexandre Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), l'oncle même de Talleyrand, qui n'était encore que coadjuteur de l'archevêque en titre, c'est-à-dire Mgr de la Roche-Aymon lui-même, lors du sacre de Louis XVI, en 1775.
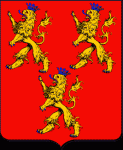
(Cette coïncidence (qui se traduit aussi par une similarité héraldique, les Talleyrand-Périgord blasonnant de gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur) aurait dû faire l'objet d'une note dans la foulée de la précédente, mais une escapade d'une semaine en Périgord justement avec une partie de la famille en avait retardé la rédaction.)
15:20 Publié dans Le Facteur de coïncidences | Lien permanent | Commentaires (0)











